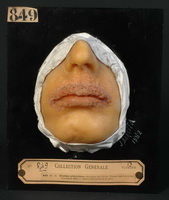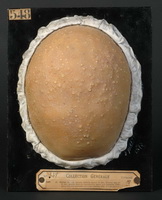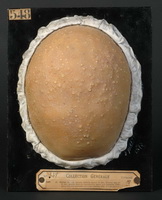
|
Favus |
Le favus est une maladie contagieuse qui
atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la
nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par
Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce
moulage, est caractéristique.
"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est
couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux
sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un
demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,
quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont
d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de
souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes
et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois
semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,
dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le
godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte
laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans
l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son
centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet
et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement
faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".
Avant même qu'on eût appris à reconnaître le
favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était
l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus
ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre
résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de
telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on
arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé
que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en
raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation
à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au
XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.
La longueur du traitement, sa difficulté et la
contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à
l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de
cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en
1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole
Lailler. |
|
Coll.
Musée de l’hôpital Saint-Louis |
|
|

|
Favus |
Le favus est une maladie contagieuse qui
atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la
nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par
Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce
moulage, est caractéristique.
"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est
couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux
sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un
demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,
quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont
d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de
souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes
et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois
semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,
dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le
godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte
laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans
l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son
centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet
et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement
faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".
Avant même qu'on eût appris à reconnaître le
favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était
l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus
ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre
résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de
telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on
arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé
que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en
raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation
à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au
XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.
La longueur du traitement, sa difficulté et la
contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à
l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de
cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en
1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole
Lailler. |
|
Coll.
Musée de l’hôpital Saint-Louis |
|
|

|
Favus |
Le favus est une maladie contagieuse qui
atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la
nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par
Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce
moulage, est caractéristique.
"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est
couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux
sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un
demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,
quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont
d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de
souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes
et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois
semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,
dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le
godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte
laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans
l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son
centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet
et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement
faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".
Avant même qu'on eût appris à reconnaître le
favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était
l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus
ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre
résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de
telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on
arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé
que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en
raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation
à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au
XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.
La longueur du traitement, sa difficulté et la
contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à
l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de
cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en
1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole
Lailler. |
|
Coll.
Musée de l’hôpital Saint-Louis |
|
|

|
34 |
Le favus est une maladie contagieuse qui
atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la
nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par
Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce
moulage, est caractéristique.
"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est
couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux
sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un
demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,
quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont
d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de
souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes
et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois
semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,
dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le
godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte
laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans
l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son
centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet
et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement
faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".
Avant même qu'on eût appris à reconnaître le
favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était
l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus
ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre
résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de
telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on
arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé
que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en
raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation
à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au
XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.
La longueur du traitement, sa difficulté et la
contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à
l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de
cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en
1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole
Lailler. |
|
Coll.
Musée de l’hôpital Saint-Louis |
|
|

|
Favus |
Le favus est une maladie contagieuse qui
atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la
nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par
Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce
moulage, est caractéristique.
"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est
couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux
sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un
demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,
quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont
d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de
souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes
et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois
semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,
dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le
godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte
laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans
l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son
centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet
et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement
faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".
Avant même qu'on eût appris à reconnaître le
favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était
l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus
ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre
résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de
telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on
arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé
que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en
raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation
à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au
XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.
La longueur du traitement, sa difficulté et la
contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à
l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de
cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en
1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole
Lailler. |
|
Coll.
Musée de l’hôpital Saint-Louis |
|
|